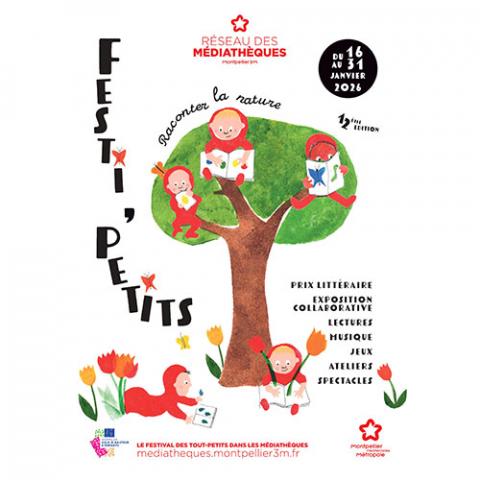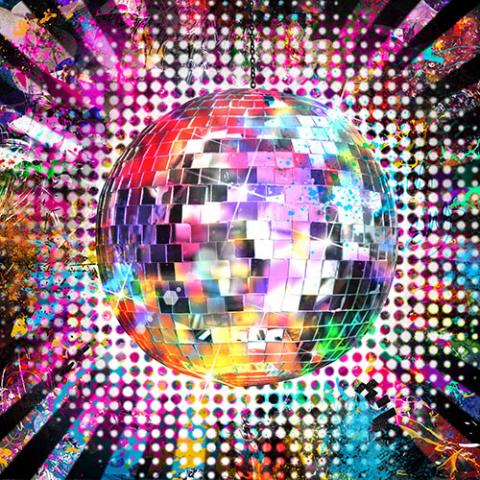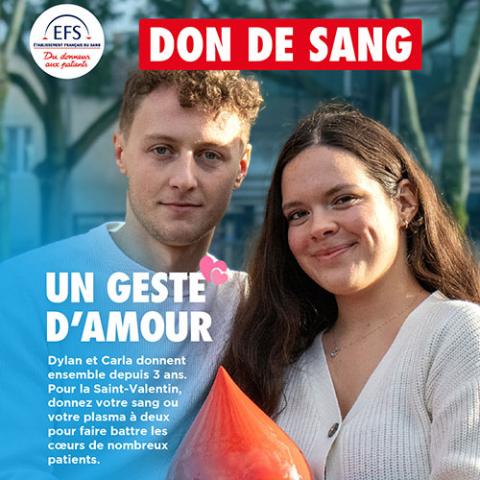En Février 2026
Localiser
Samedi 31/01
Festi'Petits (0/3 ans)
Samedi 07/02
Journée Steampunk
Samedi 07/02
Réunion publique jardins familiaux
Dimanche 08/02
Loto
Mardi 10/02
Atelier jeux de société
Vendredi 13/02
Soirée festive
Samedi 14/02
Journée Gallo-Romaine
Dimanche 15/02
Corso & Bal des Pailhasses
Lundi 16/02
Soirée vidéo carnaval
Mardi 17/02
Bal de l'Echelle
Mardi 17/02
Atelier jeux de société
Mercredi 18/02
Journée des Pailhasses
Samedi 21/02
Concert Symphonique
Dimanche 22/02
Match football seniors
Lundi 23/02
Collecte de sang
Mercredi 25/02
Conseil municipal
Vendredi 27/02